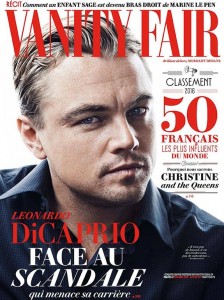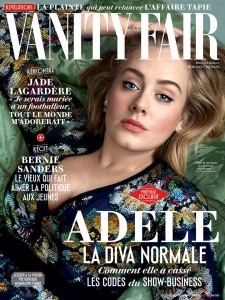Le froid, le chaud
Le laid, le beau,
Dans les allées de M&O je me déshabille au fur et à mesure que je me réchauffe. Dehors, il fait un froid de canard. J’avance à pas lents jusqu’à l’idée de me retrouver nu. Non, je ne suis pas beau ! je fonds plutôt sur celles que je trouve belles. Je les déshabille du regard. Bienheureux au rendez-vous des yeux, des pensées interdites et des désirs projetés.
J’avance dans le souvenir d’un soir d’hiver parisien où je me frayais un chemin dans le froid pour aller retrouver ma dulcinée. Plus je m’approchais d’elle, plus je redoutais le contraste promis de son épiderme douillet et chaleureux au contact de mon corps glacé.
Je virevolte dans mes pensées tel le filament incandescent de l’ampoule à l’intérieur de son enveloppe de verre.

La Femme M&O est nue. Je me balade dans les ouillères du salon. Je vendange des objets dont je la pare ; des objets figés pour un corps en mouvement. Je pose sur elle des instants photographiques. Je l’habille d’accessoires et de maintes breloques. Je projette sur sa silhouette un habit malicieux qui la cache aux yeux de tous, nous devenons un couple exclusif et muet. Je la suis et déroule sur sa peau une parure décorative. Je la précède et m’amuse à chercher encore et toujours la petite note supplémentaire qui complètera le tableau. Mais hélas, elle finit par s’évanouir dans les allées. Elle s’échappe. Je continue ma visite et ma quête d’émerveillement. La femme idéale n’existe pas, c’est une chimère. Je m’éloigne à petits pas de la femme objet de mes passions pour me diriger vers l’objet à découvrir qui ravira mon enthousiasme. La beauté que l’on prête à un être ou à une chose n’est-elle pas la projection sur lui des caresses que l’on désire recevoir ?
Venue de bohème, cette intentionnelle beauté apparaît magnifiquement au détour d’un stand sous la forme de deux vases de cristal. Sobrement mis en lumière ils se donnent la réplique ; immobiles dans leurs jeux de transparences colorés, ils ignorent avec superbe la fascination provoquée sur les admirateurs qui tournoient autour d’eux. Ils se présentent aux yeux de tous impassibles et sereins. Il y a mille et un trésors à découvrir sur le salon, à caresser du regard, à mettre dans sa besace ; il n’y a pas de hasard, juste une belle rencontre, puis le début d’une conversation où le poids et la pureté du cristal entre en résonnance avec la conséquence et la légèreté de l’existence.
Il me fallut attendre jusqu’au printemps pour revoir le vase commandé dans une boutique à Paris. Je le rapporte à la maison pour l’offrir à mon épouse, la femme avec qui je partage le plus clair de mon temps – surtout la nuit !
En effeuillant l’emballage du cadeau renait le dialogue interrompu quelques semaines plus tôt. Nous redécouvrons le vase ensemble. C’est toujours le même objet et aussi un autre. Il quitte le domaine public pour rejoindre notre sphère privée. Nous le regardons à la lumière de nouveaux jours.